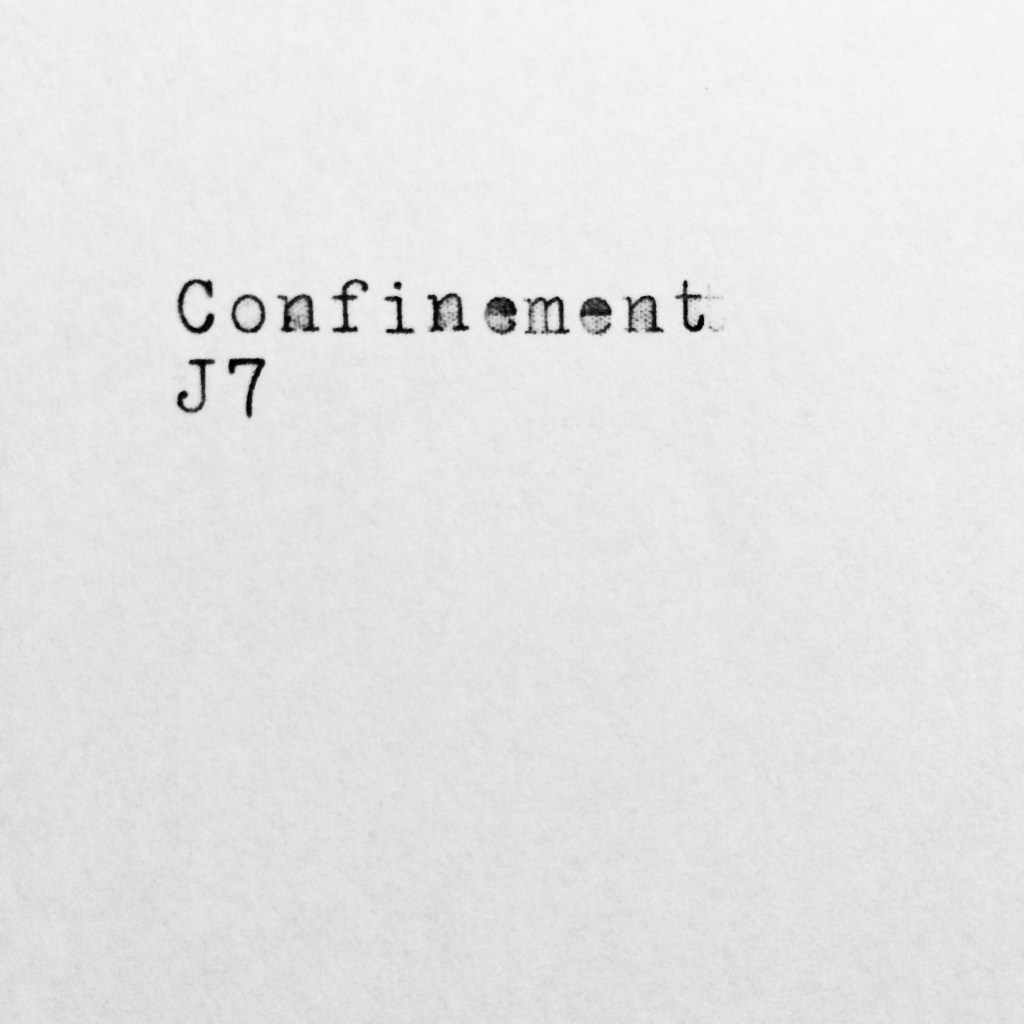
Slow day aujourd’hui. Lundimanche, comme on dit. Une sieste le matin et une l’après-midi. Est-ce qu’au bout d’une semaine on peut encore parler de jet lag ou est-ce simplement le décalage horaire de cette nouvelle vie? On a beau écouter Kraftwerk – Europe Endless, le rythme rapide des synthés n’est qu’un rappel du ralentissement obligé qu’on vit en ce moment. Europe Endless certes mais seulement dans nos têtes: on se demande quand est-ce qu’on franchira les frontières de la France, si on reverra Berlin avant le mois de juin, l’Angleterre avant l’hiver et l’Italie avant que Capri soit fini. Et moi qui atterris, je me dis qu’il est fini et bien fini le temps où je prenais l’avion sans me poser de questions.
Une vie confinée c’est une vie locale, presque en autarcie – la Biocoop a toujours du riz cambodgien et des avocats péruviens mais est-ce que ces imports du bout du monde ont une fin? Est-ce qu’on va devoir se réhabituer, comme je l’ai fait à New York presque par réflexe pavlovien, à consommer des rutabagas et autres légumes racines dont on a perdu l’habitude depuis les dernières famines? Les grands principes dont on se targue en tant que bobos – je mange local et de saison et bien sûr bio – sonnent comme un réflexe de survie lorsque les seules options sont ce qui reste dans les rayons des supermarchés dévalisés, non achalandés, quasi fermés. C’est quoi, ce truc-là? Un céleri-rave? Un topinambour?
Une soupe de brocolis et de fanes de carottes, et au lit. Le menu aurait pu être le même en temps de liberté, pour être honnête, mais il a un goût de disette lorsqu’on se ravitaille en l’absence de l’abondance habituelle. Céleste fait deux découvertes: Kraftwerk et le pain au levain. Elle stocke des réserves de mie dans ses joues rebondies et se rue sur les miettes qu’elle a laissées en charpie à côté de mon assiette. Peur de manquer ancestrale, inscrite dans son ADN? Tu sais en Algérie Hélène on vivait enfermés, me rappelle ma marraine, prête à tenir un siège avec ses provisions. Je repense aux bidons étiquetés sucre, pâtes et farine dans le chalet de mes grands-parents.
J’ai fait un gâteau au chocolat. Pour la farine, l’embarras du choix: blanche, complète, châtaigne ou sarrasin? Là encore l’abondance, l’indécence de même oser écrire sur tout ça alors que je vis une époque aussi joufflue que mon enfant. Un peu de café moulu dans la pâte. Dans le magazine Regain, une restauratrice raconte que sa seule concession à la mondialisation dans le garde-manger est le café, mais qu’elle réfléchit à un mélange avec de la chicorée. Pour moi, le joker serait le gingembre, mais mon goût pour le jusqu’au-boutisme me pousse déjà à me rabattre sur autre chose, un épice, un condiment ou une plante qui puisse pousser dans mon potager. De la coriandre? De la menthe?
Perdue dans mes pensées, interrompue par Ambroise qui me demande: Ça va? T’es plutôt bien dans un monde où on ne prévoit rien? On rit un peu jaune, ma phobie de l’engagement rebrandée en philosophie Zen (ou l’inverse) ayant longtemps été un point de dissension entre nous. Tu ne veux rien prévoir! Ce n’est pas moi, c’est la vie qui est comme ça! Présentement, je lui réponds en souriant: Oui, je suis ravie de voir le carpe diem revenir sur le devant de la scène. Et lui? Il me dit: Moi je me pose encore régulièrement la question du lendemain, mais c’est un exercice quotidien. Céleste, assise sur une couverture par terre, est notre maîtresse: son univers entièrement contenu dans un morceau de pain.
Europe endless
Life is timeless
Europe endless
Parks, hotels and palaces
Europe endless
Promenades and avenues
Europe endless
Real life and postcard views
Europe endless
Elegance and decadence
Europe endless
Céleste s’est endormie après avoir transporté son univers d’un bout de pain à mon sein. Au téléphone, à côté, Ambroise parle à Tom, qui vit depuis plusieurs années en organisant des voyages pour des clients. L’industrie du tourisme est évidemment une des plus touchées; les écologistes espèrent un changement durable des mentalités mais il n’est pas évident qu’une des conséquences du confinement temporaire ne soit pas au contraire, une recrudescence des voyages dès le couvre-feu levé. Je parle avec romantisme de vie locale mais j’envisage difficilement de me cantonner à la France forever. J’ai reçu en quittant New York les résultats de mon test d’ADN: 40% de sang d’ailleurs, ça ne compte pas pour du beurre.
Dans la bibliothèque (confinement hardcore dans une maison qui tient plus du manoir du Cluedo que d’un studio), Ambroise a délaissé son livre sur l’Everest pour un autre: American Tabloid de James Ellroy. Plus français que lui, tu meurs, mais dans ses lectures il est baroudeur. Depuis hier, il vit dans l’Amérique des années 60, entre la mafia et la mifa Kennedy. Sur le papier, je ne suis pas loin de lui: les mémoires de Michelle Obama ont été mon dernier achat sur le territoire américain lundi. C’est un gigantesque cliché, de dire que les livres font voyager. L’immobilité forcée, sans avion ou train à portée de porte-monnaie, oblige à le revisiter: on savoure chaque mot si l’on sait que peut-être on ne (re)verra jamais Chicago ou LA.
A côté de la porte d’entrée, ici, une photo est affichée: tous les deux affublés de perruques peroxydées devant un mur de conserves Campbell à Los Angeles. C’était une exposition rétrospective sur Andy Warhol à la Revolver Gallery, pendant un séjour en Californie il y a trois ans. Nos habits sur cette série de photos sont aussi colorés que les lithographies: j’ai un jean rose et des Birkenstock jaune fluo. Mes Birkenstock d’aujourd’hui sont les mêmes, mais roses, et mon jean favori ces jours-ci est un modèle tie and dye encore plus éblouissant que le précédent. Je me rêve régulièrement minimaliste, et je reviens toujours à mes premières amours chromatiques. Ou est-ce l’inverse?
On ne change pas, on met juste les costumes d’autres sur soi – c’est Céline Dion qui chante ça, et j’y pense à chaque fois que je m’imagine différente, ancrée, confinée dans une vie qui peut-être ne me ressemble pas. Mais on n’oublie pas l’enfant qui reste presque nu, les instants d’innocence, quand on ne savait pas. Six mois que Céleste est là et que sa présence me ramène à ma propre enfance. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l’on fait des choix. Je suis retournée à New York avec elle, soi-disant pour la dernière fois, j’ai renvoyé à Paris les caisses de livres et les habits maximalistes que j’avais laissés là-bas. On ne change pas, on ne cache qu’un instant de soi.
Les caisses de livres sont encore en transit entre l’Amérique et la France. Quelle chance! Elles ne sont pas encore confinées, elles. Elle ont encore la possibilité d’imaginer une vie peut-être aux Canaries, peut-être sur un iceberg à la dérive, peut-être ailleurs qu’à Paris. Une toute petite fille, chante Céline sur les hauts-parleurs de l’ordinateur. Ma toute petite fille à moi dort, le décor de ses rêves inclut déjà les skyscrapers de Manhattan et les océans de nuages par le hublot de l’avion. Le ciel sera toujours là, les rêves seront toujours là. Tous ces milliers de rêves. Il est minuit et demi, Ambroise entre dans le salon et m’interrompt: Il est temps d’aller se coucher, si tu en es à Céline Dion.
