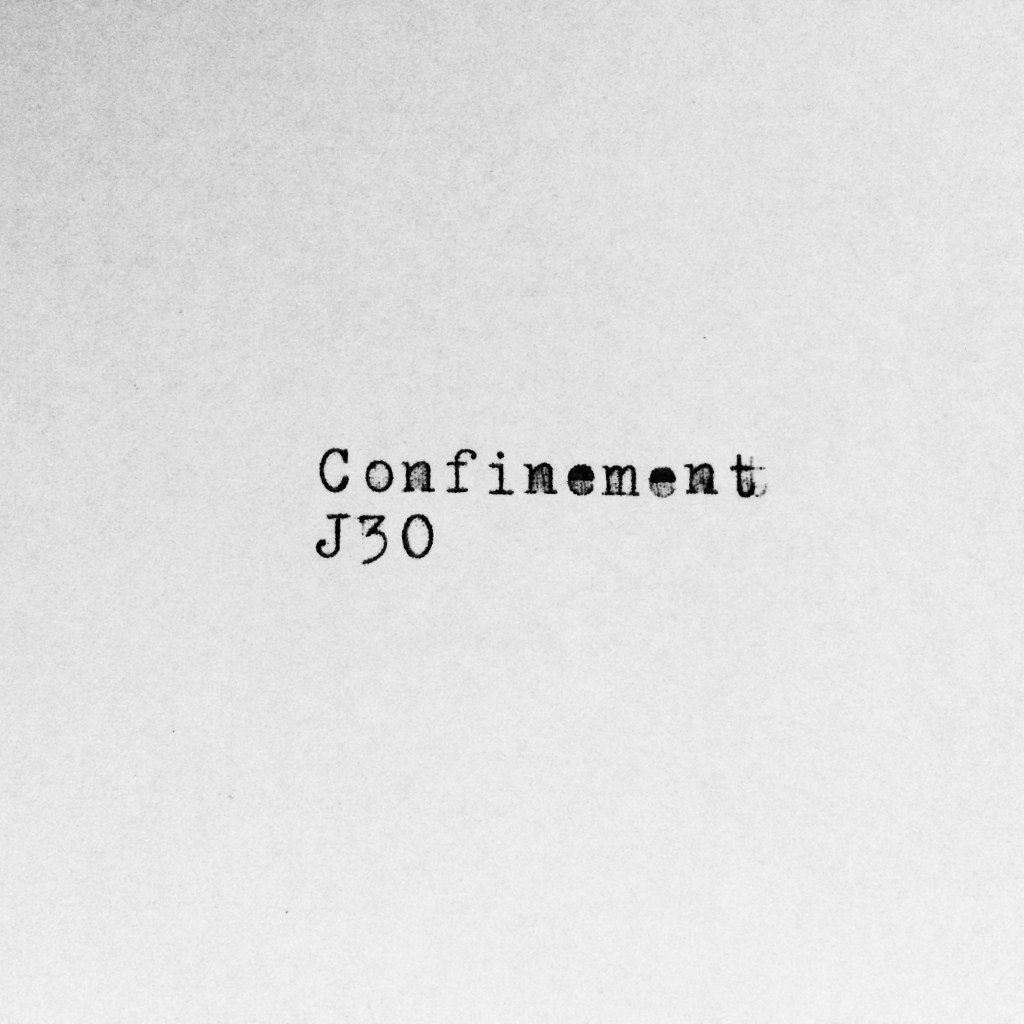
J’ai fait ma promenade le matin, cette fois. Je suis sortie pour aller acheter un produit de première nécessité: des cinnamon buns de Circus Bakery. J’ai un peu hésité, vérifié le trajet sur Google, 2,4km à pied est-ce vraiment une bonne idée? Ce n’est peut-être pas sérieux de violer le règlement par gourmandise, même si ledit règlement précise une distance d’un kilomètre pour la promenade mais aucune pour le ravitaillement. Un loophole! Je me suis ruée dedans, landau et Célesteau in tow. J’ai été bien punie pour mon audace: la boulangerie était pleine de sacs exhalant un fumet délicieux de cannelle et de pain… réservés pour les gens qui avaient commandé la veille. Je suis repartie bredouille et me suis rabattue sur un croissant.
Encore une journée chewing gum, à la fois toute petite, une boule collante et qui s’est étirée en un long filin. Aujourd’hui, rien: j’ai décidé ce matin de m’abandonner, d’accepter, de me donner. J’ai déclaré mes impôts pendant la sieste de Céleste. Le reste de la journée je l’ai laissé filer, refermant tranquillement le tiroir de mes projets, me disant: ce sera pour après. Je me suis allongée après le déjeuner pour récupérer de la courte nuit, des 30 salutations au soleil et de la marche jusqu’à Circus Bakery. J’ai dormi contre le petit corps chaud dans le lit en fin d’après-midi. Ambroise est entré, j’ai dit: Je suis si fatiguée, il a eu l’air incrédule ou étonné ou un peu fâché. C’est lui qui est devant son ordinateur toute la journée. Lui qui est fatigué.
Je n’aime pas ça, m’abandonner au sommeil en pleine journée. M’allonger, me reposer. Admettre que je ne suis pas un appareil performant branché sur une prise de courant. Never complain, never explain. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a une crise sociale sans précédent en ce moment, c’est écrit dans le journal. Je n’ai pas le droit de ne pas sourire dans ma vie de Polly Pocket parfaite. Je souris, mais c’est dessiné sur mon visage. Derrière, on voit comme à travers un pentimento sur un tableau de Leonardo: les efforts pour donner le change, pour faire résistance. Toute la couche supérieure se fissure. On est tous faits de plusieurs couches de peinture. Au bout de combien de temps de confinement se craquelle-t-elle? Qui va nous restaurer après?
Celeste dort, elle a déjà bien dormi cet après-midi, et ce matin après la longue promenade jusqu’à la boulangerie. Elle n’a pas demandé pourquoi soudain la routine change, pourquoi on va marcher au saut du lit. C’est pratique, un bébé. Ça ne dit rien mais ça ne ressent pas moins. On s’est fait plein de câlins. D’habitude, je lui apprends que quand une couche se craquelle il y a des moyens de restaurer la peinture: on écoute de la musique, on fait un dessin, on lit, on travaille, on danse, on écrit. Aujourd’hui, rien. Parfois, il faut accepter de ne pas être divertie, et s’allonger, et accueillir avec soi la mélancolie, lui faire une place dans le lit. C’est le meilleur moyen, à mon avis, pour éviter, espérer qu’elle ne s’installe pas toute la vie. La regarder, la saluer, l’embrasser.
Dans L’histoire sans fin, un film qu’on regardait enfants mes frères et moi et qui est tiré d’un livre allemand, il y a des marécages de la mélancolie. Le cheval du héros s’embourbe dedans. Atreyu, le héros, sait, lui, que tout est affaire de renoncement. Si l’on accepte de se laisser aspirer par les sables mouvants, c’est terminé. Pourtant c’est bien connu: lutter aussi est peine perdue. Je n’ai pas la réponse à ce dilemme. Je lutte avec beaucoup, beaucoup d’énergie. Je ne me suis jamais sentie embourbée jusqu’au cou – jamais assez longtemps pour que ce soit alarmant. J’arrive toujours à me redresser, à me hisser au-dehors, à me sauver. Depuis que Céleste est née, j’ai une énergie décuplée. Je ne veux pas qu’elle me regarde depuis le talus comme Atreyu.
Mes parents sont dans la maison de mes grands-parents au bord de l’océan. Au téléphone aujourd’hui, on s’est demandé: est-ce qu’ils y étaient déjà restés aussi longtemps, avant? Mon père passait deux mois sur cette même plage, chez ses propres grands-parents, quand il était enfant. Là, ça fait cinq semaines. Ça commence à ressembler aux vacances d’été illimitées. Combien de temps faut-il pour que nos couches se craquellent, comme on perdait le sérieux accumulé toute l’année à mesure que les semaines de juillet, d’août avançaient? Combien de temps pour désapprendre? J’ai l’impression qu’il y a du sable sur le matelas, peut-être des miettes que j’ai apportées en m’y allongeant cet après-midi. Je préfère penser à du sable.
C’est inconfortable, ce sable. Et à certains égards, c’est inconfortable, d’être confinés. Est-ce que, comme le sable sous les doigts de pied, ça peut nous reconnecter? Aux autres, au monde, à nous-mêmes? Est-ce qu’on peut en restant chez soi retrouver ce qu’on a égaré, se souvenir de ce qu’on a oublié? Accueillir les cicatrices, les courbatures, les craquements comme au yoga, s’observer, s’écouter doucement, sans jugement. Être son propre kiné, masseur, sa propre mère. Être tendre avec soi pour l’être avec le reste quand le commerce humain reprendra. Faire de belles bulles roses avec les journées chewing gum, même si moi je n’ai jamais réussi. Et s’octroyer des cinnamon buns, aussi. (Circus Bakery livre à vélo dans tout Paris.)
